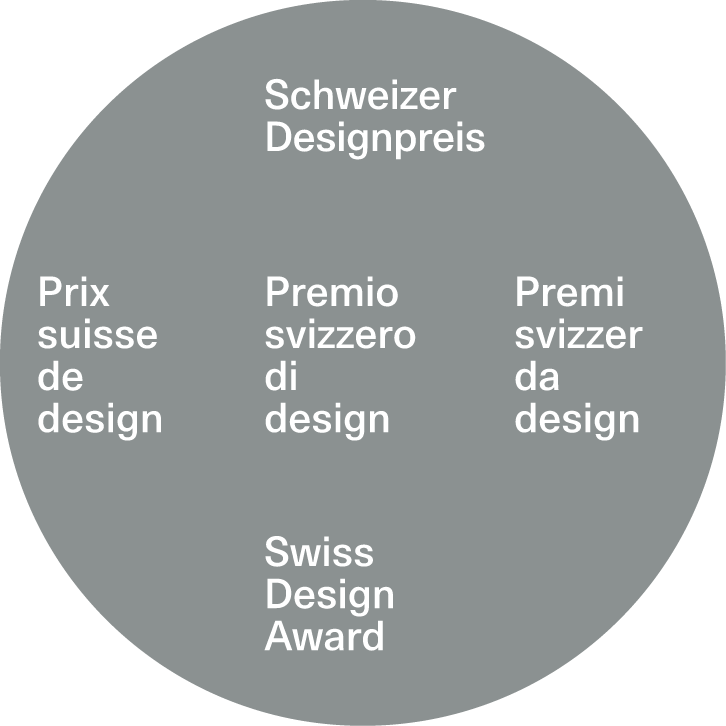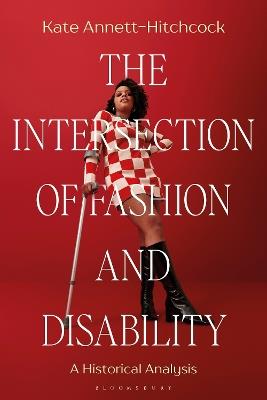« There is no Disabled Fashion, there is Only Fashion« . Tel est le point de départ du livre de Kate-Annett Hitchcok « The intersection of Fashion and Disability : A Historical Analysis », qui a le mérite d’inscrire la relation entre la mode et le handicap à l’intérieur de l’histoire de la mode, et de mettre en lumière la convergence de différents domaines disciplinaires tels que médecine, droit, design, politiques publiques et innovation technologique.
Cette recherche explore les solutions adoptées dans le temps pour permettre aux personne vivant avec un handicap physique et moteur de s’exprimer à travers la mode, un désir que l’on retrouve dans toutes les époques et dans toutes les cultures à travers des habits dont les adaptations ont toujours fait partie de l’histoire de la mode.
La recherche met au centre les droits civiques des consommateurs et des consommatrices en situation de handicap qui ont existé en tout temps, et leur droit de participer au monde de la mode en tant que créateurs / créatrices et activistes, à travers la récupération des expérimentations et des prodromes de la mode adaptative, ainsi que les histoires personnelles longtemps restées dans l’anonymat.
L’autrice présente en huit chapitres une histoire silencieuse que le modèle dominant de la mode occidentale a occultée ; elle reconstruit avec précision les points de jonction entre la mode et le handicap, de la Renaissance à aujourd’hui. Un travail de pionnier où on retrouve la récupération des modèles de mode adaptative présents dans les collections des musées au XIXe siècle, les parcours de réhabilitation entre les deux Guerres, les innovations réalisées dans le milieu militaire, les retombées des droits civiques entre les années 1970 et 1990 sur les politiques et sur les avancées de la recherche technologique aux États-Unis.
Selon l’autrice, la créativité employée dans l’adaptation des habits et dans la création de dispositifs pour assister les personnes en situation de handicap était présente bien avant que l’industrialisation de la mode occidentale prenne le contrôle du secteur. Si ces adaptations se cachent dans les collections d’habits de la noblesse et des classes plus aisées, on les retrouve également dans les solutions à modules géométriques des peuples indigènes du Nord de l’Amérique. Au début du XVIIIe siècle, le gilet de William III facilite par exemple le mouvement des bras à travers les ouvertures et les coutures. À la même époque, les chaussures coupées comme des pantoufles pour pouvoir les mettre et les enlever sans les mains (comme le brevet FlyEase de Nike) ont été popularisées par des personnes influentes comme le roi d’Angleterre Henry VIII. , dont la petite taille était une attraction du cirque Barnum, a été une référence pour la mode de son temps : habillée par les plus grands couturiers, elle était considérée comme « The Queen of beauty ».

Selon Kate-Annett Hitchcok, la standardisation des tailles au XIXe siècle et l’avènement du Prêt-à-porter au XXe ont eu comme conséquence une perte de compétences et d’attention pour les besoins particuliers des personnes. En 1747, le couturier R. Campbell écrit dans un livre célèbre[1] que l’habilité et la responsabilité de son métier consistent à habiller tous les corps. Si cette philosophie est encore présente dans les manuels du XIXe siècle, elle disparaît de ceux du siècle suivant.
Dans les années 1920, la mode devra toutefois s’intéresser à une nouvelle catégorie de personnes : les vétéranes de la Première Guerre mondiale et les enfants devenus handicapés à cause de la polio auront besoin de solutions pour s’habiller et se déshabiller de manière autonome, et accélérer ainsi leur réinsertion sociale. En Angleterre, la designer en situation de handicap Annie Bindon Carter créé à cette époque la « Painted Fabric NC », et Ernest Thesiger la « Disabled Soldiers Embroidery Industry », deux histoires à succès issues de laboratoires thérapeutiques destinés aux vétéranes.
Aux États-Unis, il faudra attendre les années 1950 pour trouver un équivalent dans la célèbre marque Functional Fashions Line.
S’appuyant sur des sources primaires et secondaires (histoire de l’art, illustration), Kate-Annett Hitchcok retrace les exemples américains de mode adaptative dans les collections des musées au XIXe siècle, les parcours de réhabilitation entre les deux guerres, les innovations issues du domaine militaire et les effets des luttes pour les droits civiques entre les années 1970 et 1990 sur les politiques et sur les avancées technologiques. Elle analyse par exemple l’impact du Rehabilitation Act de 1973 et de l’Americans with Disabilities Act de 1990 sur le dépassement des stéréotypes esthétiques associés aux personnes en situation de handicap, condition nécessaire qui a amené à la conception du Design universel ainsi que à la recherche technologique de tissus intelligents, de fermetures magnétiques ou d’impressions 3D.
Le livre retrace le passage du modèle médical au modèle social du handicap, jusqu’à la classification de l’Organisation mondiale de la Santé de 2021, qui a reconnu la mode comme un outil d’autodétermination et d’expression de soi, et le fait de s’habiller et faire du shopping de manière autonome comme une forme de Self Care.
Si le défis du XXe siècle a consisté à sortir la mode de la sphère médicale pour réaliser des produits beaux et fonctionnels à la fois, pour la designer Grace Jun, cofondatrice de l’Open Style Lab de New-York, il faudrait aujourd’hui ramener la beauté dans les lieux de soin et dans tous ces endroits en marge de la société qui demandent des solutions esthétiques et fonctionnelles.
Pour finir, dans les derniers chapitres de son livre Kate-Annett Hitchcok retrace les exemples récents de mode inclusive, y compris les stylistes et les auteurs invisibilisés par le récit dominant de la mode. Elle offre des recommandations pour actualiser le passé, et une riche bibliographie qui invite à poursuivre sa recherche.
[1] « The London Tradesman »